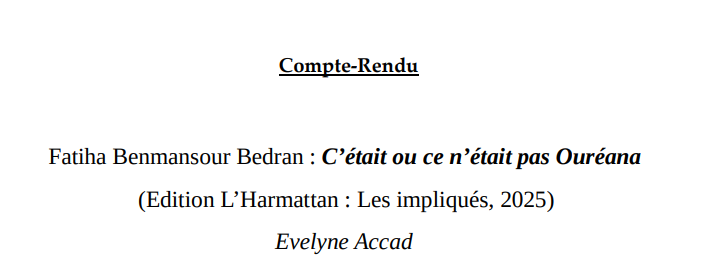Fatiha Benmansour Bedran : C’était ou ce n’était pas Ouréana
(Edition L’Harmattan : Les impliqués, 2025)
Evelyne Accad
Le roman de Fatiha Benmansour Bedran : C’était ou ce n’était pas Ouréana est une
réussite d’écriture, de narration qui tient à bout de souffle, de sensualité toutes en nuances
et en couleurs délicates, les guerres entre sultans, empereurs et émirs sont racontées d’une
plume de maître(sse) de roman historique similaire à celle d’Amin Maalouf dont Fatiha se
dit inspirée !
Mais Fatiha nous fait aller plus loin dans l’analyse de ces conflits mélanges de haines, de
jalousies, de possessions maladives qui entraînent inévitablement à la destruction des êtres
sensibles et tendres. Car elle nous montre qu’au-delà de ces querelles ancestrales et
classiques, une autre lecture peut être faite : « Les voies impénétrables du ciel s’ouvrent à
toi ! Laisses-y tes empreintes, des marques fortes et indélébiles, les sceaux d’une vraie
princesse ! (p. 137) Là réside tout le message de cette « vraie princesse » qu’elle soit ou ne
soit pas Ouréana, ou Fatima la petite fille des émirs de Séville du XIIème siècle.
Elle n’est pas dans la haine mais dans la tendresse. Elle n’est pas dans la possession mais
dans le don, elle n’est pas dans la jalousie mais dans la complicité. C’est le message fort et
important qui ressort de ce roman ! Il nous redonne un peu d’espoir dans ce monde où tout
semble s’écrouler sous le poids des guerres répétées dont on ne voit pas la fin excepté un
cataclysme final si rien n’est changé.
Dans mes échanges avec Fatiha, elle m’a appris que ce projet d’écriture avait mûri cinq ans
et conduite dans l’immersion de la culture portugaise et espagnole, elle la marocaine mariée
à un libanais. Et ce brassage des cultures et des religions ressort magnifiquement dans ses
lignes où les conflits interreligieux prennent une toute autre dimension. Car elles sont
vécues dans l’expérience personnelle, la souffrance et la volonté de la reconnaissance de
l’autre loin des clichés habituels. Et là réside une autre force de ce roman sur lequel il y
aurait beaucoup à dire mais sur lequel je ne m’arrêterai pas aujourd’hui.
Et comme me le dit aussi, si bien, Fatiha : « Mon expérience du Liban, où je réside, m’a
appris que ceux qui vivent la guerre se retrouvent rarement dans les récits des historiens ou
des journalistes. » Dans cet échange personnel avec Fatiha, j’ai compris qu’en fait, elle
avait pu exprimer toutes ses douleurs et son mal-être d’écartelée vive entre toutes ses
appartenances culturelles, ethniques, religieuses, sociaux, etc., grâce à l’écriture.
Ce fut pour elle une véritable thérapie et c’est ce qui nous permet aussi, à nous lecteurs, de
ressortir de cette expérience, renouvelés, en quête de vérité transformatrice telle qu’elle est
exprimée dans le poème finale du roman.