Categories
- ARCHIVES (3)
- Arts et Littérature (20)
- Écologie et Développement (3)
- Économie (4)
- Géopolitique (14)
- madaniya (199)
- POINTS DE VUE (1)
- REVUE DES IDÉES (289)
- Sheimaa El Oubari (2)
- Société (11)
Subscribe
Thanks for subscribing!
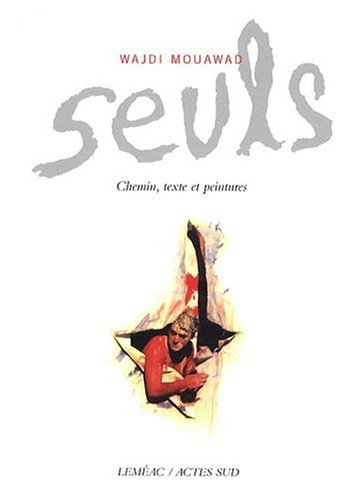
L’obsession du nostos dans Seuls de Wajdi Mouawad.
Par Carole MEDAWAR.
Notice bio-bibliographique
Professeur Assistant à l’Université Libanaise (section 1), Carole Medawar est titulaire d’un doctorat en littérature française de l’Université Saint Joseph de Beyrouth. Elle est l’auteure d’une thèse sur la poésie symboliste belge, dont un extrait a été publié dans le volume 33 de l’annale Acanthe (USJ), sous le titre : Le Testament du poète. Elle a participé à plusieurs colloques et a publié des articles portant sur la littérature francophone et le genre poétique.
Résumé
La dramaturgie de Wajdi Mouawad lève le voile sur une blessure lancinante, un obus dans le cœur ardu à déloger. Sur un canevas morcelé et une scène alimentée de réitérations nostalgiques, Seuls retrace le malaise du personnage, Harwan, hanté par un passé qui ressurgit de manière acerbe. Le protagoniste ressasse en effet la déchirure et la perte identitaire, causées par la guerre civile libanaise et le fatal exil à Montréal, dont il impute la faute à son père. Il s’agit donc d’analyser Seuls comme l’un des palimpsestes mouawadiens d’une expulsion du giron et d’un incoercible retour aux sources. Une lecture psychanalytique de l’odyssée intérieure de Harwan révèle un Moi-peau angoissé. Afin d’émousser la culpabilité œdipienne et de fuir l’hostilité ambiante, le protagoniste se retire au sein de sa chambre-coma, qui prend les dimensions d’un musée. Dans une perspective schopenhauerienne, le chemin artistique restitué par Harwan oblitère l’obsessionnel et nie la souffrance du vouloir-vivre.
Mots-clés
Identité, mémoire, retour du refoulé, angoisse, Moi-peau, vouloir-vivre, art.
Pourquoi as-tu brisé ce fil / où mon âme amarrée était au repos ? […] Tu devais savoir pourtant que cela est dur, / très dur d’être arraché à son pays, / mais plus dur encore d’être arraché à son enfance. (Mouawad, Le Sang des promesses 91)
Les vicissitudes de l’expatriation raniment souvent des images-souvenirs, tapies dans les méandres de la mémoire. « Je ne sais pas si c’est un signe ou une torture / Cette voix dans mon enfance comme une pomme », écrit Georges Schehadé (45). Loin de consoler le désorienté, la réminiscence des vergers de l’enfance ne peut qu’acérer son déchirement : « le vert paradis des amours enfantines » (Baudelaire 95) se consume en absence. Ces ombres obsessionnelles hèlent Harwan, protagoniste de Seuls, pièce de théâtre à caractère autobiographique[1] de Wajdi Mouawad. Arraché à son pays natal, le Liban, à son village, Deir-el-Qamar, Harwan émigre avec sa famille à Montréal, afin de fuir les ravages de la guerre civile qui éclate en 1975. Désaxé, acculé à l’ailleurs, il ressent une vive nostalgie, définie par Heidegger comme la « douleur que […] cause la proximité du lointain » (Essais et conférences 125). La séparation d’avec la terre-mère se voit imputée au père dont la décision arbitraire scarifie le parcours existentiel du fils. Car l’exil, comme la guerre, constituent autant d’assauts de l’individualité : ils ouvrent des brèches identitaires difficiles à colmater. Aussi le métissage de Harwan se heurte-t-il à un échec, d’autant que le passé le hante. Le solo polyphonique, où le dramaturge conjugue intentionnellement plusieurs arts et techniques[2], retrace de fait un manque qui génère confusion intérieure, douleur et quête obsessionnelle des origines perdues. Harwan s’interroge sur son identité, ressent le besoin impérieux d’y consacrer une thèse de doctorat, mais semble de prime abord inapte à répondre aux questions qui le taraudent.
L’étrangéité longtemps refoulée rejaillit brutalement et provoque l’introspection : le coma dans lequel plonge le personnage, suite à son effondrement dans la cabine photomaton (144), l’engage sur le chemin du nostos. Cependant, de quelle manière l’odyssée intérieure de Harwan lui permet-elle de restituer son passé ? Bien plus, dans quelle mesure ce cheminement rétrospectif pourrait-il être perçu comme salubre et libérateur ? Il s’agit de s’intéresser dans un premier temps à la rémanence du traumatisme sous l’angle de la psychanalyse : le retour du refoulé laisse sourdre la question des origines, une rancœur du fils à l’égard du père castrateur et une volition de retourner au bercail. Ces souvenances signalent non seulement un fonctionnement hystérique, mais encore une altération de l’enveloppe psychique, prémisse qu’il serait fondamental d’éclairer à travers le concept du « Moi-peau », développé par Didier Anzieu dans son ouvrage éponyme. En effet, l’émigré esseulé présente des symptômes d’une identité écorchée et défaillante. Dans un deuxième temps, la trajectoire du retour révèle une aspiration au repos éternel : le principe de nirvâna semble conjurer l’angoisse éprouvée par le bouc émissaire de l’exil. Dans cette perspective, une étude schopenhauerienne de Seuls, pièce métaphysique, souligne la nécessité de se réfugier dans l’art. Grâce à la peinture et à la contemplation du tableau évocateur de Rembrandt, Le Retour du fils prodigue, Harwan tente de s’affranchir du vouloir-vivre, pour atteindre la quiétude de la connaissance pure.
I- Le reliquat de l’exil
Appartenant aux récits de survivance, Seuls retrace la tragédie de l’identité fourvoyée. L’échec de l’assimilation dénonce la démoralisation de Harwan qui, vingt-cinq ans plus tard, ne parvient toujours pas à se retrouver entre deux systèmes de référence : son terroir, le Liban, et la société d’accueil, Montréal. Le protagoniste se trouve happé par le passé qui fait incursion dans son quotidien, sclérosant la réorganisation du Moi.
1- La survivance du traumatisme
Une ambiance d’inquiétante étrangeté pèse sur la pièce. Ce familier qui devait rester caché dans l’ombre pour garantir l’homéostasie psychique, se manifeste à la conscience du protagoniste. Rattaché à l’angoisse de castration, l’unheimlich (Freud, IE 10) s’explique en l’occurrence par l’image recrudescente du déracinement de la mère-patrie. L’engramme de ce mouvement d’expulsion brutale, qui n’est pas sans rappeler le traumatisme de la naissance, ravive l’étrangeté au monde que Heidegger définit comme le ne-pas-être-chez-soi (Être et Temps 146). En effet, Harwan « [s’]interroge depuis [s]on mémoire de maîtrise sur la question de l’identité » (125). Il commande à « la librairie du Square » un livre intitulé Fenêtre (133). En outre, sa thèse de doctorat a pour sujet : « Le Cadre comme espace identitaire dans les solos de Robert Lepage » (125).[3] Ces mises en abyme reflètent d’emblée le problème lancinant de l’appartenance fluctuante et, concurremment, le besoin de circonscrire les frontières pour se situer et s’orienter dans l’espace. L’obsession des racines, catalyseur d’une trajectoire analytique, aboutit à un travail prolifique de mille-cinq-cents pages (140). Néanmoins, cette thèse demeure sans conclusion, ce qui corrobore l’échec de l’assimilation. Dès la protase, le spectateur entre de plain-pied dans une scène de dénouement : intitulée paradoxalement « Conclusion », elle laisse deviner l’impasse de la quête. De fait, le monologue liminaire du personnage s’avère être un cauchemar au terme duquel « il se défenestre » (127) : l’angoisse de perdition de Harwan se veut invasive et mortifère. La thèse qui doit répondre à la question « Qui sommes-nous et qui croyons-nous être ? » (125) se trouve de prime abord invalidée : « […] malgré la richesse de mon sujet, je me sens dans l’obligation de m’arrêter ici, n’ayant pas trouvé ma conclusion […] je commence à comprendre qu’il n’y a sans doute pas de conclusion à ma thèse » (127). L’expérience de l’incertitude intellectuelle propice à l’inquiétante étrangeté fomente l’incompréhension de soi[4]. Les interrogations et les négations itératives trahissent ainsi une pathologie ancrée dans le temps reculé de l’infantile.
D’entrée de jeu, les admonestations de Layla, sœur de Harwan, ciblent entre autres son « vieux téléphone à roulette sans aucun bouton » (130) qui ne sonne pas : « Change le téléphone ! […] Change le téléphone, tu as compris ! » (130). Le dysfonctionnement de l’appareil, métonymie de Harwan, indique sa fixation tragique à un monde révolu. Ensuite, le protagoniste évoque son enfance (151,152) dans le discours central de la pièce (scène 04), lorsqu’il s’adresse à son père, apparemment dans le coma[5]. Il ne peut s’empêcher de ressasser la dialectique spatio-temporelle du passé euphorique et du présent stérile sur le mode de la détresse : « Je me suis rendu compte combien tu aimais le soleil et aujourd’hui, toute cette neige », « […] Beyrouth et la mer… ici c’est quarante centimètres de neige » (151). Ressurgissent des souvenirs en latence, rendus par la polysyndète qui scande le discours récursif : « […] et si je retrouve le silence, est-ce que tu crois que je retrouverais la peinture et si je retrouvais la peinture papa, est-ce que tu crois que je recommencerais à parler en arabe ? » (151). L’expatrié souffre d’un complexe de castration ; il formule son désir, « métonymie du manque à être » de la mère (Lacan 623), symbolisée par la langue perdue[6]. Le polyptote retrouver et le préfixe re[7], doublés de la modalité interrogative, réapparaissent plus loin : « Il faudrait tout redéployer pour retrouver l’enchantement d’avant. Parce qu’il y avait bien un enchantement, papa ? » (149). Cependant, la fonction phatique du langage se trouve avortée, ce qui heurte Harwan au mutisme de son géniteur dans le coma. L’explication du problème identitaire réside en fait dans la dissension entre le père et le fils, rapportée à la scène 02 (H). Le travail de recherche oblige Harwan à annuler son déjeuner familial, suscitant la colère et les remontrances du père :
« Ma thèse / Je pars / […] / Ma thèse / Papa / Ton époque n’est pas la mienne / Je rajouterai la culpabilité / Tout / Si j’avais vécu la guerre ce serait peut-être plus simple / Papa, j’ai trente-cinq ans, […] tu m’engueules. / […] Les traditions, les conventions, l’argent, aller manger chez son père tous les dimanches ça n’aide pas / À chaque conversation tu me rappelles que je n’ai pas vécu la guerre. Je pose un geste, tu me dis que ce n’est pas le geste que tu aurais posé. Je lève un bras tu me dis que j’aurais dû le baisser, je pars tu me dis que je dois rester je reste tu me dis que je dois partir ! / […] il est difficile de poser un geste qui soit précisément à moi […] ». (135, 136).
Les stichomythies décelées dans les interstices du dialogue mettent en exergue un fils muselé par le père castrateur. Harwan ajoute : « Mes habits ne sont pas à moi » (136), symbole du rapt de l’identité. Il blâme les mesures de coercition de son géniteur autoritaire qui le rendent inapte à décliner son appartenance ethnique. Le double bind, ou discours paradoxal délivré par le père symbolique, représentant par déplacement la société vampirisante, brime les gestes phalliques du fils – motions pulsionnelles. Harwan se regimbe a priori contre son géniteur. En effet, la didascalie finale de la scène 02 suggère un parricide symbolique, prémonition du coma de la scène 04 : le protagoniste « raccroche. Débranche son téléphone de la prise murale. » (136). Harwan ne veut en aucun cas obtempérer à l’instance surmoïque répressive, incarnée par l’imago paternelle. Or, l’indication scénique qui précède la tirade de la scène 04 précise qu’il « rebranche le téléphone dans la prise murale » (145), symbole du renouement du contact avec le père. Cette démarche doit a posteriori mener Harwan à comprendre l’origine de son malaise, pour que se résolve le clivage du moi. Ainsi, le discours avec le père comateux, détenteur de la clef des origines aux yeux du fils, se lit comme un règlement de comptes intergénérationnel imminent. Interroger le père revient à éclairer la problématique de la thèse de Harwan, où s’inscrit l’énigme fondamentale de l’identité posée par le Sphinx dans le mythe d’Œdipe : Qui est l’homme ? Qui suis-je ? Le protagoniste dépaysé tente tout d’abord de s’identifier à son géniteur. L’hypotypose atteste cette vision fascinée du père, modèle idéalisé par le fils : « Je te vois, toi, élégant […] avec un long manteau […], tu ressembles à un chanteur d’opéra italien » (148). Mais cette virilité paternelle contraste avec l’impotence filiale : « Je veux dire comment ils font les autres ? Ou bien si c’est ça, moi je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas… je veux dire toi tu as eu l’Italie, et Bagdad et le Caire et Beyrouth et la mer » (148). La syntaxe hypothétique, lacunaire et répétitive relative à Harwan métaphorise la castration qu’accentue la double négation, contrairement au panégyrique du père. Ce dernier subjugue son fils féminisé. Dépeint à travers l’énumération de ses prouesses ubiquitaires, renforcées par le pouvoir de l’auxiliaire avoir, il est perçu comme le détenteur de l’attribut phallique. Le constat velléitaire de Harwan : « Tu aurais été fier de moi » (152), lève le voile sur l’échec du mécanisme d’identification. Dès lors, l’étrangéité éprouvée par le Moi face à l’Autre, qui obture son adhésion à la société des hommes, provient de l’instance législatrice. D’ailleurs, le père reste silencieux tout au long de la scène centrale de la pièce, battant en brèche l’idéal du moi du fils qui cherche vainement à se détacher du Moi idéal patriarcal : Harwan n’arrive pas à s’affirmer[8]. Ceci dit, faute d’interlocuteur, il ne peut « avoir » le phallus, à comprendre comme objet imaginaire, signifiant du désir duquel Harwan est privé : « Qu’est-ce qui est à moi aujourd’hui ? / Non / Très peu de choses / Très peu / À peine » (136).
Le protagoniste ne parvient pas à y voir clair en lui-même : « Comment on fait pour voir ? » répète-t-il à deux reprises, avant de poursuivre : « Comment on fait pour se crever les yeux et pouvoir enfin voir notre sens, notre rythme, notre vie, notre place ? » (152). Le choix du genre théâtral – étymologiquement « lieu où l’on regarde » – tout comme la « cabine photomaton », où Harwan subit un accident vasculaire cérébral (120), participent du champ visuel. Ils se rapportent en l’occurrence à l’angoisse de castration refoulée et réapparaissant à l’occasion d’un état amoureux. La scène 02 traduit cet imaginaire anxiogène. À travers un appel téléphonique, le protagoniste apprend à sa sœur Layla qu’il a rompu avec Léa : « je lui ai rendu les clés j’ai pris mes affaires je suis parti » (129). Deux scènes plus loin, suite à la projection de son « diaporama d’amour », il recontacte son amante intransigeante : « Allô Léa, c’est moi / Mais pourquoi ? / Non attends / Léa / Attends ! » (133). C’est cette éjection brutale qui provoque le retour du refoulé : elle aiguise le déchirement narcissique et le sentiment d’impuissance qui hantent le rapport désirant à la femme. Il faut alors saisir dans ces images obsessionnelles un fonctionnement hystérique[9], poussant le protagoniste désinvesti de sa virilité à « dout[er] de tout » (Mouawad, Seuls 151).
2- Un Moi-peau défaillant
Harwan porte un regard désabusé sur ses ambitions velléitaires : « Je voulais être étoile filante, ensuite océanographe, ensuite ingénieur biomécanique et là, professeur à l’université. J’ai l’impression d’un déclin » (151). Le souvenir infantile de l’étoile filante remonte à la conscience. Il ravive la menace de castration traumatique : « […] pour quelle raison vous m’avez fait croire, quand j’étais petit, au Liban, avec les voisins, que pointer une étoile, ça pouvait vous faire pousser des verrues aux doigts ! Pourquoi vous m’avez fait croire ça ? » (148). L’interdiction de lever le doigt, image d’émasculation, inhibe le désir turgescent : « compter les étoiles sans les pointer c’est assez compliqué » (148), renchérit Harwan. En conséquence, il renonce à devenir étoile filante, Abou Ghassan lui ayant expliqué qu’elles sont « guerrières » (149), à savoir masculines. De surcroît, Harwan blâme son père non seulement de l’avoir exilé (150), mais surtout de l’avoir empêché d’emporter avec lui ses peintures de « ciels de la nuit » (149), échec de la sublimation[10]. La crise œdipienne ne trouve donc pas de résolution : le morcellement mental résulte d’un surmoi qui refoule le désir et de l’idéal du moi qui ne parvient pas à le sublimer. L’image effrayante des verrues[11] sur les doigts se rapporte étymologiquement à la défiguration et à l’enlaidissement. Elle éclaire un défaut du Moi-peau, avili par les nombreuses menaces de castration provenant d’un environnement défaillant. Didier Anzieu définit ce concept comme une « structure intermédiaire de l’appareil psychique » (27), dépendant de la famille et du milieu culturel. La peau doit être lue comme
« Donnée originaire à la fois d’ordre organique et d’ordre imaginaire, comme système de protection de notre individualité, en même temps que comme premier instrument et lieu d’échange avec autrui [et] où l’interaction avec l’entourage trouve sa fondation. » (Anzieu 25).
Or, Harwan exhibe une peau passoire qui rend impossible tout refoulement, et conséquemment, toute protection. L’écriture polyphonique de Seuls, au même titre que les imbrications spatiales, incendient ces strates dermiques de la souffrance. « Avoir mal et s’habituer à avoir mal ? Gérer l’ennui perpétuel, le manque d’enthousiasme. » (151) : interrogation et assertion confirment un mal invétéré qui corrode le Moi. D’ailleurs, l’image hypnagogique de chute à la fin de l’exposition exprime la profonde insécurité ressentie par le protagoniste. À l’instar de Meursault, anti-héros de l’absurde, Harwan est un étranger en inadéquation avec un milieu qui le rejette. « Vous êtes pas d’ici, vous… » (153), ironise l’employé de la quincaillerie, lorsque Harwan lui demande quelques éclaircissements au sujet du papier peint qu’il a acheté pour redécorer son appartement et qui s’avère être une nappe. Ce symbole connote la quête inconsciente d’une chaleur perdue. Toutefois, le sarcasme de l’Autre xénophobe ravive la brèche identitaire : « Peut-être que chez vous on mange sur les murs… » (153). Aussi, face au commentaire discriminatoire, Harwan constate-t-il amèrement sa vulnérabilité : « Non. Je ne suis pas d’ici » (153). En outre, lorsqu’il communique son adresse mail à Lynda Beaulieu, il doit épeler son prénom à maintes reprises pour se faire comprendre, et surtout la lettre h : « ache / […] ” a, c, h, e ” pour le premier / ” ache ” pour h. / Harwan / Libanaise / La guerre » (133). D’un côté, les débris d’une période révolue entravent l’acculturation de l’allochtone au sein de la société montréalaise. De l’autre, émergent les écueils du retour vers un territoire natal dont le personnage ne possède plus la langue. « Comment on dit ça en arabe […] je ne suis même pas foutu de dire fenêtre en arabe ! », « Comment dit-on mémoire en arabe ? » (151, 184). Dans cette « confusion des expériences agréables et douloureuses » (Anzieu 27), l’odyssée de Harwan éclaire une constellation de l’absence à travers le topos du ubi sunt[12] : « Te souviens-tu du parfum des figuiers sauvages ? Te souviens-tu de l’alignement des vignes ? […] Te souviens-tu de la couleur du ciel ? » (136, 139). L’incantation met l’accent sur le berceau sans failles du ciel natal, mais source d’amertume, puisque « jamais [on ne pourra] entrer deux fois dans le même fleuve » (Platon 44). D’ailleurs, l’onomastique du protagoniste révèle son endolorissement. En effet, Harwah[13] est un substantif arabe qui signifie aigreur ou âcreté. Il s’agit d’une sensation de brûlure de la gorge, de la poitrine et de la tête due à une douleur ou à un courroux. Harwane est l’adjectif de Harwah. Ce prénom est donc porteur du tourment du dasein et de la colère de ne pouvoir se cerner. Une brûlure – obus dans le cœur[14] – que Harwane laisse éclater, dès la protase, en joual, au moment où il constate l’aporie de sa recherche : « cette hostie de thèse reposant finalement sur une théorie qui est en train de totalement crisser le camp, tabarnac ! » (127). Déchiré par les aléas de la guerre, entouré d’une famille où la présence de la sœur cherche à compenser vainement l’absence de la mère, le Moi-peau de Harwan est la métaphore de sa déconstruction et de son aliénation à l’imago maternelle.[15] Le protagoniste mal décramponné aspire à la mère-peau.[16] En conséquence, Le Retour du fils prodigue de Rembrandt[17] n’est autre qu’une image-psyché, révélatrice d’un univers de non-mère :
« Père, fils, frère, sœur… À force de regarder, ça me saute aux yeux ! Quelqu’un manque ! La mère. La mère n’est pas là. […] Or, si la mère est absente au moment où son fils revient, ce n’est pas parce qu’elle est occupée ailleurs, mais certainement parce qu’elle est morte ! Voilà ! Le fils parti, la mère est morte entre-temps ! […] Un jeune homme est parti si longtemps de chez lui qu’une fois revenu il a perdu l’usage de la langue maternelle. » (Mouawad, Seuls 69).
Le drame de l’identité vacillée se lit dans le coma spéculaire de la scène 05. Harwan « se voit allongé sur un lit. Il se voit intubé. […] Il se précipite contre la fenêtre bloquée. Il cogne contre la paroi » (161, 163). Le fils réalise qu’il est lui-même tombé dans le coma. C’est la « sensation diffuse de mal-être » (Anzieu 27) qui enclenche la léthargie, puisque le Moi-peau recherche la contenance de l’enveloppe originelle. Ainsi, lorsque Layla visite son frère à l’hôpital, elle évoque le passé : les ragoûts libanais, les anecdotes de leur mère et leur appartement à Beyrouth. Harwan l’écoute, en se lavant dans « un petit bain en bois », symbole matriciel : la didascalie précise que « son corps est rouge » (168). Cette souffrance se délaie dans l’eau chaude (164) et suinte à travers les pas du protagoniste : « traces rouges » (168). Même la membrane est rouge (169), espace du foyer psychique meurtri aux rhizomes de l’exil et aspirant à la chaleur utérine. Le suicide onirique de la scène prémonitoire correspond à ce retour au sein maternel, moyennant une réparation de la culpabilité œdipienne. Or, faute d’interlocuteur, l’identification au père absent ne peut se faire que dans l’intégration du coma, où Harwan a le même destin qu’Œdipe : il s’énuclée pour mieux voir et pallier le manque de limites[18], avant de se réfugier dans la peinture. « Sa main attrape un couteau. Il erre. Il s’arrête. Il se crève les yeux : ses yeux saignent. Il s’éventre. Il erre le couteau enfoncé dans le bas-ventre » (171). L’automutilation extériorise une « tentative dramatique de maintenir les limites du corps et du Moi, de rétablir le sentiment d’être intact et cohésif » (Anzieu 42). En effet, Harwan restitue les limites de son terroir dans sa chambre-coma, comme le précisent les didascalies suivantes :
« Il arpente son territoire. Les traces de ses pas forment un rectangle […]. Il se dirige vers la membrane qui le sépare de la chambre d’hôpital. Il se voit toujours couché. Il se colle contre la membrane et y imprime la trace de son corps rouge. Contre la paroi solide qui sépare en deux la grande membrane : Harwan écrit son prénom “Harwan” de droite à gauche. » (168, 169).
La mise en scène d’un rituel imaginaire permet la réappropriation symbolique de l’écorce identitaire perdue.
Les tentatives de baliser le présent se trouvant achoppées au passé, Harwan entreprend un voyage intérieur (scène 05) afin de ravauder la déchirure. « Tout n’est pas perdu », répète-t-il trois fois (150). En effet, il recouvre sa « valise » dont son père l’avait privé : « À la place des habits, il ne trouve que des pots de peinture et des pinceaux » (160). La restriction éclaire un seul itinéraire : l’art, issue sublimatoire, s’impose comme médium du quiétisme.
II- Un solo métaphysique
Les linéaments de la pensée schopenhauerienne traversent Seuls. Pareil à Willy Protagoras, artiste peintre qui se séquestre au sein des waters dans la pièce éponyme de Wajdi Mouawad[19], Harwan se soustrait au monde dans son coma. Tous deux fuient l’hostilité extérieure : une manière de rétablir l’état primitif[20], en échappant aux affres du vouloir.
1- L’affranchissement du vouloir-vivre
Une vision pessimiste de la condition humaine ressort de la réflexion de Harwan : « Qui sommes-nous et qui croyons-nous être ? » (125). La réponse se trouve dans le dénouement de la pièce : « Des aveugles qui se pensent doués de vision ! » (184). Le message dramaturgique prend un tournant métaphysique : l’homme ne perçoit le monde qu’à travers le voile de Maya. C’est ce que rappelle expressément le passage de « Al Gondol » (Mouawad, Seuls 49), chanson de Mohamed Abd el-Wahab : « Anâ man d’ayya’a fî al-Awhâmi ’umrahu ». En d’autres termes : « Je suis celui qui a perdu sa vie dans les illusions »[21]. La mise en boucle de ce passage (153) traduit les appétences inextinguibles de l’être humain. De plus, Harwan condamne ostensiblement la morosité du monde sensible : « […] quand la vie banale te dévore papa, tires-tu une joie profonde à te dire que tu deviens, dans le ventre de la vie banale, une vie banale ? » (152). La question rhétorique réfléchit la roue d’Ixion, métaphore du désir insatiable, qui enchaîne l’être à son incurable misère[22]. L’ennui, expérience métaphysique, génère la souffrance et appelle à l’assouvissement du manque qui, une fois comblé, relance le supplice. L’individu doit réaliser son inconsistance dans sa confrontation avec le monde absurde. L’illusoire s’esquisse dans la tragique circonvolution des mots : « Harwan, […], tu as eu un accident, c’est un accident que tu as eu », « Harwan, tu as eu un accident et tu es dans le coma », « Harwan, c’est un accident que tu as eu. […] il faut qu’on te le répète, on nous a dit qu’il faut répéter […] » (161). Chiasme et écholalies fustigent implicitement le néant du monde. Bien plus, Harwan dénonce les maux[23] causés par les carnages incessants : « Rien de neuf sinon dans le monde. Mis à part les guerres et les massacres » (148). La pièce montre l’éternel retour des passions asservissantes et l’inanité de l’histoire, responsable de la perte identitaire. Le bouc émissaire de l’exil déplore par ricochet son statut de « désorienté »[24], jeté dans un univers de ressentiment et de cruauté. La souffrance irrémissible laboure le paysage dystopique nourri d’illusions :
« Désastre. […] Marcher au milieu des déchets du monde. […] Tu les connais toi les sanglots des volcans ? Tu les connais toi les épluchures des étoiles ? Tu les connais toi les cassures des dents sur les gencives des fragilités ? Ce monde qui déchante ? Mais l’innocence meurt toujours ! […] Dans mon ventre vide il y aura à jamais un vide. » (Mouawad, Le Poisson Soi 77, 78).
L’agressivité, née du conflit des vouloirs-vivre, est « un mal terrible qui exige le sacrifice des étoiles » (Mouawad, Seuls 149). L’être pour l’être, pulsion aveugle, ne répond à aucune fin. Obéissant à l’instinct de conservation, le corps, incarnation de la volonté de vivre, est assiégé de besoins. Or, tel Persée, Harwan doit nier le pulsionnel pétrifiant, image du pendule oscillant d’un mal – la souffrance – à un autre – l’ennui –, sans trêve (Schopenhauer 394). Il réalise qu’il ne peut accéder qu’à une chimère : « ce petit bonheur de pauvre » (Mouawad, Seuls 152). En ce sens, Mouawad déclare que son protagoniste « aura à trancher la tête d’une méduse : la vie banale et ennuyeuse à laquelle il se destinait ! » (Seuls 116). La Gorgone fait bien référence à la concupiscence que suscite le champ scopique. Ainsi, l’auto-énucléation de Harwan dans son coma[25] répond à la morale du détachement et de l’ascèse prônée par Schopenhauer, au détriment de la jouissance et de l’engendrement. Ce qui explique le choix d’une trame dramaturgique à rebours, délivrance du samsara[26], comme le révèlent les titres des scènes : « Conclusion » (01), « Téléphone » (02), « Internet » (03), « Père » (04), « Voyage » (05), « Corps » (06), « Conscience » (07) et enfin « Esprit » (08). Dans sa tentative de sonder le monde en tant que représentation phénoménale, soumis à la juridiction du principe de raison suffisante (espace, temps, causalité), la conscience percute l’irrationnel : l’illusion. On comprend pourquoi la thèse de Harwan, qui étudie le théâtre de Lepage à la lumière de la sociologie de l’imaginaire (133), ne trouve d’autre aboutissement que le leurre. Le protagoniste fait ainsi le procès de sa recherche, lieu expérimental de la souffrance du sujet pris dans les rets de l’espace et du temps : « un vrai robinet ! » qui s’ouvre sur le néant, « ennui perpétuel » (151). L’incomplétude de la connaissance accentue la vanité, comme le soulignent les questions rhétoriques formulées dans la conclusion de la thèse : « et si, moi, je devais retourner vers ce qui m’attend, comment ferais-je pour le trouver, pour m’en souvenir ? » (184).[27] Mais à quoi réfèrent les pronoms « le » et « en », sinon à un déictique paradoxalement indéfini : « ce » ? L’hypermnésie, le temps[28], l’intellect n’apportent qu’agitation et heurt. La déprise de l’ego s’avère nécessaire pour accéder à l’essence des choses.
À cet effet, éclairé par l’intuition objective, Harwan médite la réalité métaphysique du monde : « Il se lève. Met de la musique. » (130). « Il va vers la fenêtre. Il referme les rideaux. Il s’assoit au sol. » (158) S’affranchissant de la tyrannie du vouloir, il s’élève vers la contemplation pure de son corps précaire : « Il se voit toujours couché. » (168). De plus, les indications scéniques précisent qu’il « pose sa thèse au sol. La feuillette puis la rejette. Temps. […] Du pied, il rejette sa thèse. Temps. » (158). La répulsion à l’égard du travail intellectuel met en exergue le rejet du divertissement. Harwan se plonge également dans un silence monacal, comme le laissent entendre les six occurrences du « Temps » (158), scandant les didascalies.[29] La question de Layla qui reste sans réponse rejoint cette acception du détachement : « Est-ce que t’es déjà très loin ou t’es encore présent ? Dis-moi » (168). Par son silence, Harwan s’extirpe du monde phénoménal. Il échappe au sentiment de manque, catalyseur de maux, d’autant que « pour nommer une chose, [il faut] l’avoir perdue » (Kristeva 9). Qui plus est, le coma le dégage de la gangue du vouloir-vivre. Il correspond au nirvâna : extinction selon l’étymologie sanscrite ou suppression des tensions qui ramène l’individu à l’inorganique. Schopenhauer le définit comme l’affranchissement intellectuel et émotionnel résultant de la renonciation au vouloir-vivre. Il s’agit donc de se couper du monde asservissant, comme l’indique le titre de la pièce. Le pluriel appelle à la connivence du spectateur, invité à se contempler dans le miroir de la scène et à intégrer, à son tour, la dimension artistique salvatrice. « On ne peut être vraiment soi qu’aussi longtemps qu’on est seul ; qui n’aime donc pas la solitude n’aime pas la liberté, car on n’est libre qu’étant seul. » (Schopenhauer, Aphorismes 174) Ainsi, Harwan entre dans le nirvâna et ne répond plus à ses interlocuteurs, qui l’empressent de se réveiller au monde comme volonté aveugle. Dans son cloître, espace de l’abnégation[30], il fait table rase de sa thèse dont « les pages sont entièrement blanches » (Mouawad, Seuls 161).
2- La voie du salut artistique
C’est bien Le Retour du fils prodigue de Rembrandt, sujet du prochain spectacle de Robert Lepage, qui pousse le doctorant à renoncer à son individualité. Sur les pas de Bernard, le protagoniste sourd muet de La Révolution prodigue, Harwan se donne pour mission de « restaurer les mains du père » (143) dans sa « travers[ée] [d]es couleurs » (184). En quête de symbolique, il se fond dans la peinture de la conversion. Il recherche l’unité essentielle de la Volonté sous le voile illusoire de la diversité phénoménale. Pur sujet connaissant, le protagoniste incarne le génie chez qui « on peut voir une prépondérance marquée de la connaissance sur la volonté » (Schopenhauer 243). « Il ne faudra pas le perdre celui-là ! Il a quelque chose » (135), répète le directeur de thèse, Paul Rusenski, à Harwan pour l’inciter à se réveiller. Cependant, le coma ne correspond pas à la mort. Il s’agit d’un état de léthargie où l’individualité s’oublie. La Révolution métaphysique de Harwan équivaut dès lors à l’anéantissement du vouloir-vivre prodigue. Force est de constater que le protagoniste fait l’expérience de la pitié, ou compassion – fondement de la morale selon Schopenhauer[31] – au moment où il quitte son géniteur dans le coma : « Il s’agenouille, enlace son père et l’embrasse » (153). L’inversion chiasmatique de la parabole évangélique du fils prodigue lève le voile sur l’identité métaphysique des êtres, c’est-à-dire leur unité : « Tat twam asi, c’est-à-dire tu es ceci » (Schopenhauer 283). En ce sens, le fils pardonne à son père et s’identifie à lui[32], transporté par la musique arabe. « Voix de Mohamed Abd el-Wahab. Il approche les haut-parleurs de la tête du lit. […] Il se lève et chante » (153). La musique[33], alliée au schème ascensionnel, consacre le moment clef où l’égoïsme cède la place à la mansuétude. Afin de réparer le spectacle des griefs à l’égard du père, Harwan met fin à la rivalité, elle-même génératrice de culpabilité. Au final, lorsqu’ « il grimpe dans la peinture » (184), il nie les propos de Rusenski qui fait l’éloge de sa thèse magistrale et lui promet une carrière brillante. L’abolition définitive de la volonté se fait dans l’abstinence et la résignation, de telle sorte que la nolonté de Harwan lui permet d’accéder au statut de père créateur.[34] Le cadre assure l’osmose du père et du fils, comme celle de tous les hommes. L’art apotropaïque et cathartique éclaire l’essence indivise de l’être. Méditer sur la peinture de Rembrandt, expression de la « suprême sagesse », permet à Harwan de parvenir à « la connaissance la plus parfaite » qui :
« Répand sur le vouloir tout entier sa vertu apaisante, le quiétif ; de là vient cette résignation parfaite, qui est à la fois l’esprit intime du christianisme et de la sagesse hindoue ; de là procèdent le renoncement à tout désir, la conversion, la suppression de la volonté qui entraîne dans le même anéantissement le monde tout entier ; de là résulte, en un mot, le salut. » (Schopenhauer 299).
La contemplation esthétique apporte de fait une délivrance du monde, « vaste champ d’ennui [duquel émane] une sensation de terre brûlée » (Mouawad, Seuls 92). L’anaplodiplose de Seuls, charpente de la pièce[35], doit donc être saisie à la fois comme le tableau du renoncement à la vie ataxique et comme une fenêtre ouverte sur l’œuvre d’art, dont la scène serait le retable. La peinture, représentation de la volonté, met à distance celle-ci et obvie à la souffrance provenant du monde, caverne des illusions. Ainsi, Harwan « repeint la paroi effaçant la silhouette » (174). De surcroît, il acquiert la clairvoyance grâce à son geste d’artiste, comme le confirme la triple occurrence de l’indication scénique : « L’esprit clair » (177). Il ne manifeste plus aucun désir de s’approprier l’objet de sa rêverie, à savoir le passé. Il jouit de sa seule apparence : « Il est en proie à une joyeuse agitation », « Une joie profonde l’envahit » (177). L’esthète, miroir de la conscience du monde, contemple silencieusement la poésie du nostos : « Bruit de vent lointain. Bruit d’oiseaux lointains. Long temps. Des oiseaux encore. […] Au loin un chien aboie. […] Des cloches sonnent […] » (164), épiphanie de l’Idée. Mû par un sentiment esthétique désintéressé, Harwan fait de son passé l’objet de sa représentation : « Il voit. » (171). L’élision du complément d’objet direct rend compte d’une conscience épurée des diktats du vouloir-vivre. Par la suite, Harwan « voit les tubes de peinture. Il voit les pinceaux. Il voit les couleurs » (171). Saisir l’éternité, telle est la vocation de l’artiste, si bien que « les papiers éparpillés » de sa thèse (171), fruits de l’intellect, deviennent toiles de peinture qui défient l’usure. Pour mieux les préserver, il les abrite dans son musée intérieur : « Les parois se déplient et se replient pour créer une chambre. Atelier de peintre » (177). L’espace intime du démiurge, où dominent les couleurs « rouge, bleu, jaune, vert » (177), n’est pas sans rappeler La Chambre de Van Gogh à Arles où l’artiste hollandais se réfugiait pour assouvir sa soif irrépressible de peindre et atteindre l’immortalité à travers ses œuvres. Dans la résurrection des ciels de nuit de son enfance, au sein de sa chambre giron, la voix artistique mouawadienne rappelle, sub specie æternitatis, La Nuit étoilée de Van Gogh : « [Harwan] peint. […] Il peint. Longtemps, longtemps, longtemps. Il peint. […] Il est allongé dans le jardin et compte les étoiles » (177). En outre, la didascalie finale de la scène de dénouement indique que « Harwan est à présent dans le ventre du tableau. Il est à jamais dans son cadre » (184). La métaphore picturale matricielle souligne la plongée dans la béatitude originelle, gage d’éternité. Aussi le temps se trouve-t-il suspendu dans l’œuvre d’art anti-destin, au sein de l’Ermitage[36], musée symbolisant le monde des Idées.
Enfin, la mise en effigie de Harwan dans le cadre pictural symbolise son accès au statut d’œuvre d’art immuable[37]. De fait, le spectateur assiste à un rituel de momification du corps comateux, à commencer par le lavement (scène 06, A, « Bain ») : « Harwan se lave » (168). Ensuite, vient l’éviscération : le protagoniste « trouve un cutter. Il s’ouvre les commissures des lèvres » (169) ; puis il s’énuclée et s’éventre (171). De plus, Harwan se déshabille, symbole de la nudité originelle[38], avant de procéder au bandelettage : « Il trouve du ruban adhésif opaque. Il enroule sa tête de papier. Il attache le papier autour de sa tête avec le papier adhésif. » (169). L’artiste se façonne de la sorte un masque qu’il embaume de peinture, un moyen de lutter contre la putrescence : « Il attrape un pot de peinture et le vide sur le papier qui recouvre son visage », « Il éjecte la peinture sur le masque » (171). Harwan « s’enroule dans un morceau de papier peint » (169), image du suaire. Arrivé à cette étape, le corps se fige au sein du réceptacle-sarcophage : cadres scénique et pictural. Harwan « inscrit son nom » sur le tableau (182), sceau d’immortalité. La métamorphose du corps en artefact « arrach[e] à l’ironie des nébuleuses le chant des constellations » (Malraux 630). Ainsi, le protagoniste parvient à la suppression complète de la volonté, ce que Schopenhauer appelle « euthanasie » (1411). L’ultime question posée par Harwan dans sa conclusion – « Comment dit-on mémoire en arabe ? » (184) –, trouve sa résolution au dénouement dans la mise en abyme picturale : le langage artistique universel se veut lieu de mémoire immuable « qui échappe aux lois du temps et de l’espace et à la loi de la gravité » (Mouawad, Seuls 182).
Le leitmotiv du retour au jardin de l’enfance met en somme l’accent sur la recherche d’une identité dérobée par les circonstances historiques et familiales, au confluent de deux mondes enchevêtrés : l’étranger et le familier. La méditation de Harwan le livre à l’angoisse, « disposition fondamentale qui [le] place face au néant » (Heidegger, Être et Temps 293) : le passé incoercible traverse le présent et réveille une peau flagellée de maux et de désirs refoulés. La désespérance du personnage mouawadien sourd des épreuves successives de rupture : la naissance, la phase œdipienne perturbée, la guerre, le dépaysement et la perte de la langue maternelle. Dans l’entrelacs de l’existence chimérique, l’odyssée du soliste doit être saisie comme un retour aux sources de l’art, palliatif à la déchirure. Le théâtre se transmute alors en ekphrasis picturale exutoire. Au sein de sa chambre où il se sonde, l’ermite se re-présente le monde pour se soustraire au flux de ses tourments, une manière de vider les abcès[39] (Artaud 73). L’univers de l’effigie dans lequel Harwan se cantonne pourrait a priori faire penser à une trajectoire régressive « par la fixation à des formes de conduites antérieures infantiles » (Freud, CLP 58), en l’occurrence la peinture. Toutefois, dans le cas de l’artiste mû par une énergie intérieure, les symptômes névrotiques se trouvent a posteriori sublimés en création esthétique. « Ainsi, […] échappe-t-il au “destin de la névrose” » (Freud, CLP 60).
Le havre artistique délivre l’esthète des scories du monde. Harwan s’adonne à la contemplation, empreinte de compassion et d’émerveillement. L’ascèse permet au fils prodigue, quémandant une représentation mentale, de métaboliser ses doléances et ses douleurs au contact de la peinture onguent, à l’instar du dramaturge qui fait appel aux « Mots mercurochrome / Sur les ecchymoses de la mémoire » dans sa quête de la « trace fossilisée » du Poisson soi (Mouawad 16, 108). L’instant épiphanique sous-tend l’accès de Harwan à la démiurgie et au cadre palingénésique où sa présence au monde frelaté s’évanouit. Dès lors, la momification de Harwan, bouclier dermique, rejoint l’idée d’Indestructibilité de la Volonté éclairée (Schopenhauer 1208). Il faut savoir « rester de marbre parce que le monde est de plomb », écrit Mouawad dans Le Sang des promesses (89), mettant sur un piédestal, contre l’implacabilité du monde, le matériau sempiternel du sculpteur : le non-être se survit dans la trouée sur l’art ataraxique.
Liste des travaux cités
Œuvres de Wajdi Mouawad
Le Poisson Soi. Boréal, 2011.
Le Sang des promesses. Puzzle, racines et rhizomes. Actes Sud / Leméac, 2009.
Seuls. Chemin, texte et peintures. Leméac / Actes Sud, 2008.
Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Actes Sud – Papiers, 2004.
Ouvrages critiques
Anzieu, Didier. Le Moi-peau. Dunod, 2006.
Freud, Sigmund. Cinq leçons sur la psychanalyse. Traduit par Yves Le Lay, Payot, 1988.
—. L’Inquiétante étrangeté et autres essais. Traduit par Fernand Cambon, Gallimard, 1985.
Heidegger, Martin. Essais et conférences. Traduit par André Préau, Gallimard, 1980.
—. Être et Temps. Traduit par Emmanuel Martinau, Authentica, 1985.
Kristeva, Julia. Étrangers à nous-mêmes. Gallimard, 1988.
Lacan, Jacques. Écrits. Seuil, 1966.
Malraux, André. Les Voix du silence. Gallimard, 1951.
Rank, Otto. Le Traumatisme de la naissance : influence de la vie prénatale sur l’évolution de la vie psychique individuelle et collective. Traduit par Samuel Jankélévitch, Payot & Rivages, 2002.
Schopenhauer, Arthur. Le Monde comme volonté et comme représentation. Traduit par Auguste Burdeau, PUF, 2014.
[1] « J’ai appris à parler français à l’âge de onze ans, écrit le dramaturge. J’ai cessé de parler l’arabe à l’âge de onze ans. Cette prise de conscience me fait croire qu’un spectacle est en train de s’ouvrir à moi. Un spectacle que j’écrirai, que je mettrai en scène et que je jouerai moi-même ». Seuls, Chemin, texte et peintures. Montréal, Leméac / Actes Sud, 2008, p. 86.
[2] Le spectacle est fait de « projections vidéo, de montages sonores, de musique, de voix, que [Mouawad] avai[t] réalisés [lui-même] », « Un Oiseau polyphonique », Préface de Wajdi Mouawad in Seuls. Ibid., p.12-13.
[3] Si Harwan se réfère à un modèle dramaturgique occidental, il ne cherche pas à affirmer son syncrétisme culturel. Mouawad explique que « les histoires racontées par Robert Lepage mettaient toujours en scène un personnage qui, quittant sa maison, tentait de découvrir le monde ; cela m’apparaissait comme l’exact opposé de mes propres histoires qui mettaient en scène un personnage égaré, tentant de rentrer chez lui ». Idem., p.45.
[4] Selon Julia Kristeva, « multiples sont les variantes de l’inquiétante étrangeté : toutes réitèrent ma difficulté à me placer par rapport à l’autre, et refont le trajet de l’identification-projection qui gît au fondement de mon accession à l’autonomie ». Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1988, p. 276.
[5] « Faire croire que le père tombe dans le coma au moment où Harwan s’apprête à partir à Saint-Pétersbourg alors qu’en vérité c’est lui-même qui vient d’avoir un accident. », explique Mouawad. Seuls, op.cit., p.119.
[6] « LA LANGUE MATERNELLE ME FAIT PENSER À LA MORT DE MA MÈRE. MA MÈRE ME FAIT PENSER À MON PÈRE QUI ME FAIT PENSER À ŒDIPE À HAMLET À CETTE MANIE QUE LES PÈRES ONT DE TOUJOURS VOULOIR SACRIFIER LEURS FILS (GUERRES, MASSACRES, FAMINES) […] », écrit Mouawad dans « Chemin » in Seuls, ibid., p.72.
[7] Mouawad précise dans sa préface ce « besoin d’aller revoir, visiter, ressentir ». Idem., p.15.
[8] « C’est dans la mesure où le père devient un objet préférable à la mère que peut s’établir l’identification terminale, celle qui aboutit à l’idéal du moi. C’est par l’identification au père (dans le cas du garçon) que la virilité est assumée. » Christian Delourmel, « De la fonction du père au principe paternel » in Revue Française de Psychanalyse, 2013/5, vol.77, p.1283.
[9] « Les traits structuraux les plus remarquables de l’hystérie s’enracinent sur ce terrain de la revendication de l’avoir. » Il s’agit de « conquérir l’attribut dont le Sujet s’estime injustement dépourvu. […] Subsiste une adhésion fantasmatique identique à l’objet phallique et à sa possession supposée, traduisant, par là même, l’aveu que le sujet ne saurait l’avoir. D’où l’existence d’un trait inaugural qui sature toute l’économie psychique de la structure de l’hystérique : son aliénation subjective au désir de l’Autre. […] la dynamique du désir va essentiellement retentir au niveau de l’avoir ». Joël Dor, « La Fonction paternelle et ses avatars » in Le Père et sa fonction en psychanalyse, Toulouse, Érès, 2012, p.60.
[10] « Tu te souviens de tous les tableaux que j’ai peints papa ? Où sont-ils tous ces tableaux ? Pourquoi on ne les a pas emportés avec nous lorsqu’on a fui le pays ? Puis tous mes pots de peinture, les tubes de couleur, les pinceaux […] On aurait pu mettre tout ça dans une valise, je l’aurais portée moi, cette valise […] », insiste Harwan. Op.cit., p.149.
[11] La même image revient dans Le Poisson Soi : « Ne regarde pas les étoiles au fond de toi ou bien les verrues te dévoreront le cœur ». Montréal, Boréal, 2011, p.85.
[12] Selon Freud, « les hystériques souffrent de réminiscences ». Cinq leçons sur la psychanalyse, traduit de l’allemand par Yves Le Lay, Paris, Payot, 1988, p.11.
[13] Il s’agit d’un H pharyngal, fricative sourde : [Ḥ]. Ce phonème n’existe pas dans les langues française et anglaise.
[14] Titre d’un roman de Mouawad publié aux Éditions Actes Sud, Paris, 2017.
[15] « […] Cet étrangement inquiétant est l’entrée de l’antique terre natale [Heimat] du petit d’homme, du lieu dans lequel chacun a séjourné une fois et d’abord. L’amour est le mal du pays [Heimweh], affirme un mot plaisant », L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p.252.
[16] Mouawad précise dans sa préface ce « besoin d’aller revoir, visiter, ressentir », Seuls, op.cit., p.15.
[17] Harwan « comptai[t] passer la matinée au musée de l’Ermitage devant Le Retour du fils prodigue de Rembrandt […] ». Ibid., p.157.
[18] Cet état pathologique est ainsi caractérisé par Anzieu : « […] incertitudes sur les frontières entre le Moi psychique et le Moi corporel, entre le Moi réalité et le Moi idéal, […] brusques fluctuations de ces frontières, accompagnées de chutes dans la dépression, […] indistinction pulsionnelle qui fait ressentir la montée d’une pulsion comme violence et non comme désir […] ». Paris, Dunod, 1995, p.29.
[19] Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Paris, Leméac, 2004.
[20] Otto Rank explique que « l’homme cherche à rétablir par tous les moyens possibles, en créateur pour ainsi dire, l’état primitif ». Il ajoute aussi que « les bagages (la malle, le coffre) [sont] une substitution symbolique de l’utérus ». Le Traumatisme de la naissance, traduit de l’allemand par Samuel Jankélévitch, Paris, Payot & Rivages, 2002, p.47, 112.
[21] Traduction personnelle.
[22] « La satisfaction d’aucun souhait ne peut provoquer de contentement durable et inaltérable. C’est comme l’aumône qu’on jette à un mendiant : elle lui sauve aujourd’hui la vie pour prolonger sa misère jusqu’à demain. » Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, traduit de l’allemand par Auguste Burdeau, Paris, PUF, 2014, p.252.
[23] « Nous sommes les oiseaux des douleurs, chacun d’entre nous est une douleur infligée, jamais refermée, oubliée, jetée ici dans l’Hadès et qui pourtant continue à tourner et à hurler et à dire son nom. Nous sommes chacun d’entre nous une blessure ouverte, béante depuis le début du temps. » Wajdi Mouawad, Inflammation du verbe vivre, Paris, Actes Sud, 2016, p.35.
[24] « Le pays dont l’absence m’attriste et m’obsède, ce n’est pas celui que j’ai connu dans ma jeunesse, c’est celui dont j’ai rêvé, et qui n’a jamais pu voir le jour », écrit Amin Maalouf. Les Désorientés, Paris, Grasset, 2012, p.67.
[25] « Voir implique notre humanité et l’œil se crève devant l’impensable », écrit Mouawad. L’Œil, Paris, Actes Sud, 2018, p.38.
[26] Opposé au nirvâna, le samsara renvoie au « monde des renaissances continuelles, des appétits et des désirs, de l’illusion des sens et des formes variables, des phénomènes de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort ». Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, op.cit., p. 1259.
[27] C’est nous qui soulignons.
[28] Quand le passé devient présent, quand la douleur des souvenirs se fait pesante, ils s’illustrent dans le vouloir-vivre : il est impossible d’envisager la conscience comme mémoire organisée et harmonieuse, la vie comme bien-être. Souffrance, maladie, folie menacent l’individu.
[29] Dans le monologue de la scène 04, le protagoniste malheureux l’avait pressenti : « Il vaut mieux se taire ! Il vaut mieux ! », op.cit., p. 151. Mais il était encore en proie au vouloir, comme le traduit la prétérition : Harwan, velléitaire, poursuit sa logorrhée, avec l’illusion de combler le vide.
[30] « Par cette abnégation, l’essence même de notre être se supprime ». Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, op.cit., p.382.
[31] Schopenhauer définit la compassion comme la « participation tout immédiate, sans aucune arrière-pensée, d’abord aux douleurs d’autrui, puis et par suite à la cessation ou à la suppression de ces maux », Le Fondement de la morale, traduit de l’allemand par Auguste Burdeau, Paris, Aubier, 1978, p.118.
[32] « Pour que mon action soit faite uniquement en vue d’un autre, il faut que le bien de cet autre soit pour moi, et directement, un motif, au même titre où mon bien à moi l’est d’ordinaire. […] Or, c’est supposer que, par un moyen quelconque, je suis identifié avec lui, que toute différence entre moi et autrui est détruite […]. Cette pitié, voilà le seul principe réel de toute justice spontanée et de toute vraie charité ». Ibid., p.117,118.
[33] Elle exprime « l’être, l’essence du monde », écrit Schopenhauer. Idem., p.337.
[34] À la page 183 de Seuls, la photographie du spectacle, correspondant à la didascalie « Il grimpe dans la peinture », montre Harwan (image de Mouawad enfant) à la place du père, au sein de la toile de Rembrandt. Op.cit.
[35] L’exposition met en scène la défenestration de Harwan qui plonge en fait dans le cadre du dénouement.
[36] Le tableau de Rembrandt se trouve au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Nous assimilons la chambre de l’artiste à cet espace cénobitique.
[37] « Le monde périt, mais je demeure », écrit Schopenhauer. À ses yeux, « l’art reproduit les idées éternelles qu’il a conçues par le moyen de la contemplation pure ». Le Monde comme volonté et comme représentation, op.cit., p.1258, 239.
[38] Dès la protase, Harwan se présente « nu au milieu de la foule ». Op.cit., p.125.
[39] « Il faut crever l’abcès de l’Histoire ! », crie Eden dans Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Montréal, Leméac, 2018, p.57.
